Sommaire
- NOTE
- 1. Les années 1990 : premières propositions et rapport Chadelat
- 2. 2006 – Chirac relance le débat
- 3. La TVA sociale : un mirage politique
- 4. 2009 – La démonstration par la CVAE
- 5. Conclusion — Ce que change une CVA bien paramétrée
- 📚 À retenir :
- 📌 Précisions utiles
- 📊 Impact sur l’emploi : des estimations variables
- 📌 À suivre…
- La disparition de la CVA comme réforme institutionnelle n’a pas empêché la poursuite de la transformation du modèle social. Aujourd’hui, plusieurs chercheurs et propositions — y compris la mienne — proposent d’en reprendre les principes. 👉 Voir : Relectures contemporaines de la CVA (à paraître)
- FAQ
- Notes & références
NOTE
Cet article propose une ressource dense et rigoureuse :
Il rassemble trente ans de débats institutionnels, de rapports et de controverses autour de la CVA.
Plutôt qu’un simple point de vue, c’est une base documentaire sourcée accessible à tous.
Elle vous permettra de comprendre comment l’idée a traversé les alternances politiques et pourquoi elle reste d’actualité aujourd’hui.
Un outil pour se repérer, vérifier les faits, et participer au débat sur l’avenir du financement social.
Depuis près de trente ans, la CVA est discutée : elle vise à élargir et stabiliser l’assiette des cotisations sociales employeurs en la fondant sur la valeur ajoutée, plutôt que sur la seule masse salariale.
À chaque fois, elle est reconnue comme faisable… puis écartée pour de mauvaises raisons. Ce voyage dans le temps montre que le problème n’a jamais été technique, mais politique.
(Pour aller plus loin, voir aussi mon mémoire complet sur la CVA et rejoindre le projet.)
1. Les années 1990 : premières propositions et rapport Chadelat
L’idée d’une cotisation sociale patronale assise sur la valeur ajoutée n’est pas née d’hier. Dans les années 1990, plusieurs économistes, mais aussi des responsables politiques et syndicaux, avancent la nécessité d’élargir l’assiette des cotisations au-delà de la masse salariale.
Du côté des économistes critiques, Paul Boccara (PCF) défend dès cette époque son projet de « sécurité d’emploi et de formation », reposant sur une assiette élargie intégrant la valeur ajoutée [1] . Pour lui, il s’agit de financer les droits sociaux par un prélèvement stable et pérenne, proportionnel à la richesse réellement créée, plutôt que par un système reposant uniquement sur l’emploi salarié, de plus en plus fragmenté par la précarité et le chômage de masse.
C’est dans ce contexte qu’apparaît le rapport au Premier ministre sur le financement de la protection sociale (Commissariat général au Plan, 1995), présidé par Jean-Baptiste de Foucauld et rapporté par Jean-François Chadelat et Catherine Zaidman. Le rapport explore plusieurs pistes, dont l’élargissement de l’assiette des cotisations patronales à la valeur ajoutée. Paradoxalement, Jean-Baptiste de Foucauld juge alors l’effet d’une CVA « négatif », estimant qu’elle pèserait sur les entreprises les plus innovatrices [40] . Le rapport mentionne aussi la possibilité d’une modulation (selon la part des salaires dans la VA), mais en souligne lui-même la difficulté pratique. Autrement dit, Chadelat n’impose pas un modèle unique : il ouvre un éventail de scénarios, en insistant sur la faisabilité technique de l’assiette valeur ajoutée [2] .
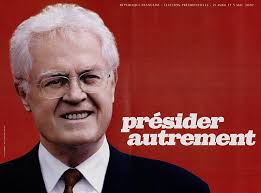
Cette réflexion se prolonge avec les travaux de Jean-François Chadelat (1997) sur la réforme des cotisations patronales. Commandés par Alain Juppé mais remis à Lionel Jospin après l’alternance, ils jugent au contraire la réforme d’assiette « inéluctable » et préconisent deux pistes : une CVA ou une modulation selon le rapport valeur ajoutée/masse salariale [40] . Cette évolution rapide — de « négatif » (Foucauld, 1995) à « inéluctable » (Chadelat, 1997) — traduit une évolution interne de l’appareil d’État, pas seulement une différence de personnes.
Cette lecture est confirmée par une analyse académique publiée en 1998 dans la Revue de l’OFCE : Henri Sterdyniak et Pierre Villa rappellent que le rapport Chadelat « préconise d’élargir l’assiette des cotisations sociales, mais suggère un mécanisme de modulation difficile à mettre en œuvre » [35] .
Pourtant, un rapport parlementaire présenté par Alfred Recours (PLFSS 1999) critique une « CVA modulée » attribuée à Chadelat et oppose qu’une CVA « à plat » serait préférable. C’est un contresens : la modulation n’était qu’une hypothèse parmi d’autres, étudiée à titre exploratoire, et sera véritablement expertisée plus tard (groupe interministériel/COE, 2006). Cette confusion a contribué à brouiller le débat et à marginaliser l’option d’une assiette valeur ajoutée dans les discussions de la fin des années 1990 [34] .
Ce que dit Chadelat au Sénat (13 octobre 1998)
Lors de son audition au Sénat, Jean-François Chadelat précise les raisons d’un basculement d’assiette vers la valeur ajoutée, en cohérence avec les pistes du rapport du Plan [2] :
- Justification économique. La masse salariale progresse moins vite que l’activité : fonder le financement uniquement sur les salaires fragilise la ressource.
- Assiette opérationnelle. La valeur ajoutée comptable est déjà connue et auditée (liasses fiscales) ; aucune difficulté technique « insurmontable ».
- Incidence et équité sectorielle. Deux usines qui créent la même VA mais avec des intensités capital/travail différentes ne contribuent pas pareil en cotisations sociales patronales aujourd’hui. Chadelat dénonce : « Une entreprise avec 100 salariés + 10 machines » vs « Une entreprise avec 10 salariés + 100 machines » — à VA égale, elles contribuent de manière inégale. Une CVA corrigerait ce biais.
- Effets attendus. Les simulations sur l’emploi montrent un effet positif mais très variable (de 40 000 à 400 000 emplois selon les hypothèses) ; l’enjeu principal est la cohérence de l’assiette.
- Mise en œuvre prudente. Introduction progressive (à la manière du déplafonnement historique des cotisations) pour éviter les chocs et donner de la visibilité.
Cette audition confirme que, dès 1998, la faisabilité et la cohérence d’une cotisation assise sur la valeur ajoutée étaient établies dans le débat institutionnel [36] .
À la fin des années 1990, la priorité politique est ailleurs : les gouvernements misent surtout sur des allègements ciblés sur les bas salaires, présentés comme un outil de lutte contre le chômage. Cette stratégie, qui culminera plus tard avec les exonérations Fillon et le CICE, s’impose dans l’agenda et relègue la réflexion sur l’assiette contributive au second plan. En pratique, la logique reste la même : réduire le « coût du travail », sans remettre en cause une assiette centrée sur les salaires.
Pourtant, comme l’ont noté plusieurs chercheurs depuis, cette stratégie a produit des résultats très limités sur l’emploi, tout en fragilisant les recettes de la Sécurité sociale. L’idée d’une CVA, elle, ne disparaît pas : sa cohérence économique et son potentiel de justice contributive lui permettront de réapparaître régulièrement dans les débats ultérieurs.
Chronologie des rapports « Chadelat » et associés
- 1994 : Rapport Maarek. Gérard Maarek (Crédit Agricole) pose le diagnostic : « il n’y a pas d’assiette de cotisations miracle » et souligne les effets pervers d’une assiette purement salariale.
- 1994–1995 : Rapport Foucauld–Chadelat (Commissariat au Plan). Présidé par Jean-Baptiste de Foucauld, rapporteurs J.-F. Chadelat et C. Zaidman. Paradoxalement, Foucauld juge l’effet d’une CVA « négatif » pour les entreprises innovatrices.
- 1997 : Rapport Chadelat (commandé par Juppé, remis à Jospin). Évolution radicale : la valeur ajoutée devient une base « inéluctable et souhaitable ».
- 1998 : Rapport Malinvaud. Opposition frontale à Chadelat : récuse l’intérêt d’une CVA et préconise des allègements ciblés sur les bas salaires.
- 13 octobre 1998 : Audition de J.-F. Chadelat au Sénat (PLFSS 1999). Défense explicite de la CVA.
- 1998 : Analyses académiques (Revue de l’OFCE).
2. 2006 – Chirac relance le débat
2.1 Le rapport administratif (mai 2006)

En janvier 2006, le président Jacques Chirac confie à un groupe interministériel la mission d’examiner plusieurs pistes de réforme du financement de la protection sociale. Pendant deux mois, des hauts fonctionnaires issus de la Direction de la législation fiscale, de la Sécurité sociale et de l’INSEE travaillent sur quatre scénarios :
- une cotisation sur la valeur ajoutée (CVA) ;
- une modulation des cotisations sociales patronales en fonction du ratio masse salariale/valeur ajoutée ;
- une « TVA sociale » ;
- une contribution patronale généralisée.
Le rapport rendu en mai 2006 est sans ambiguïté : la CVA est parfaitement faisable sur le plan juridique et technique. Elle peut être recouvrée par les URSSAF ou par l’administration fiscale, et son assiette est facilement identifiable grâce aux données déjà déclarées par les entreprises (TVA, IS). Mieux encore : les simulations macroéconomiques réalisées dans ce cadre estiment qu’une bascule partielle vers la valeur ajoutée aurait un impact légèrement positif sur l’emploi, de l’ordre de +28 000 postes. Ce chiffre n’est évidemment pas une prévision certaine, mais il montre qu’aucun risque majeur sur l’emploi n’était identifié dans ce scénario [3] .
Pourtant, ce rapport n’aura aucune suite. Quelques semaines plus tard, les avis du Conseil d’orientation pour l’emploi et la synthèse du Centre d’analyse stratégique vont donner la priorité à d’autres options, reléguant la CVA au second plan.
2.2 L’avis du COE (juillet 2006)
En juillet 2006, le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) publie un avis sur les mêmes scénarios. Contrairement au rapport administratif de mai, l’avis met la TVA sociale en avant comme piste prioritaire, relativise fortement l’intérêt d’une CVA et écarte la modulation, jugée trop complexe. La CVA est évoquée comme une option « possible », mais politiquement peu réaliste. Dans les faits, cette note de synthèse défavorable efface la portée du rapport technique favorable, et devient la référence utilisée par les décideurs politiques [4] .
Ce décalage est révélateur du fonctionnement institutionnel français : ce n’est pas le rapport d’instruction (technique) qui pèse dans l’agenda, mais l’avis de synthèse (politique). Ainsi, une option validée comme faisable disparaît du radar institutionnel, tandis que la « TVA sociale » gagne en visibilité et s’impose comme le slogan politique qui sera repris quelques années plus tard par Nicolas Sarkozy.
2.3 L’oubli de l’arrêt CJUE (octobre 2006)
Au même moment, un élément juridique majeur aurait pu changer la donne : le 3 octobre 2006, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rend son arrêt dans l’affaire C-475/03, concernant l’IRAP italienne (un impôt local assis sur la valeur ajoutée). La question posée était simple : un prélèvement sur la valeur ajoutée est-il compatible avec la directive européenne qui encadre la TVA (directive 77/388/CEE, remplacée depuis par la directive 2006/112/CE) ?
La réponse est claire : oui. La CJUE juge que l’IRAP, bien qu’assise sur la valeur ajoutée, ne constitue pas une « taxe sur le chiffre d’affaires » au sens du droit européen, et qu’elle est donc parfaitement compatible avec les traités [5] .
Cet arrêt aurait dû lever les doutes juridiques qui pesaient encore sur la CVA. Mais il est resté quasi ignoré dans les débats français : ni le rapport du COE (juillet 2006), ni les discussions politiques qui suivront ne l’intègrent. Un exemple typique de dépendance au sentier : une administration qui a tranché en faveur d’une option (TVA sociale) ne revient pas en arrière, même quand des faits nouveaux rendent crédible une alternative.
⚖️ Une idée techniquement crédible, politiquement repoussée
Depuis la fin des années 1990, toutes les évaluations techniques convergent : une CVA est faisable, tant sur le plan juridique (compatibilité européenne) que sur le plan technique (assiette et recouvrement connus). Les simulations ne montrent aucun risque majeur pour l’emploi ; au contraire, elles évoquent même un impact légèrement positif.
Alors pourquoi la CVA n’a-t-elle jamais vu le jour ? Parce qu’elle touche à une question de pouvoir : affecter une ressource pérenne et dynamique à la Sécurité sociale, c’est réduire la marge de manœuvre budgétaire de l’État. Or, depuis les années 1990, la tendance est à la fiscalisation croissante de la protection sociale (CSG, TVA sociale, impôts affectés), au détriment de la logique contributive.
Autrement dit : la CVA n’a jamais été écartée pour des raisons économiques ou juridiques. Elle a été repoussée pour des raisons institutionnelles et politiques, liées au partage du pouvoir entre l’État, la Sécurité sociale et les partenaires sociaux.
3.1 Le principe et ses faiblesses
Si la CVA est progressivement écartée après 2006, c’est parce qu’une autre idée prend le dessus : la TVA sociale. Le principe est simple : augmenter légèrement le taux de TVA (de 1 à 2 points) pour réduire d’autant les cotisations patronales. L’argument central est celui de la compétitivité externe : puisque la TVA est déductible à l’export, les produits français vendus à l’étranger seraient allégés de cette charge, tandis que les importations supporteraient le supplément de TVA. En théorie, cela permettrait de « rééquilibrer » la concurrence [6] .
Cet argument, séduisant en apparence, est pourtant fragile. D’abord, jouer sur un ou deux points de TVA ne change pas significativement les équilibres concurrentiels mondiaux : les écarts de coûts entre pays se mesurent en dizaines de points. Ensuite, rien ne garantit que la baisse de cotisations se traduise par une baisse immédiate et proportionnelle des prix à l’export. Dans les faits, l’effet sur la compétitivité reste très limité.
Plus encore, la TVA sociale est régressive : elle pèse proportionnellement davantage sur les ménages modestes, puisque la TVA est prélevée à la consommation. Autrement dit, elle transfère une part du financement social vers les consommateurs, au détriment des plus fragiles. De nombreux travaux, y compris institutionnels, ont souligné ce caractère antisocial [7] .
Enfin, la TVA sociale ne corrige en rien la question centrale du partage de la valeur ajoutée. Elle déplace la charge (du patronat vers la consommation), sans modifier l’assiette contributive. Contrairement à la CVA, elle ne fait pas contribuer les entreprises à proportion de leur richesse réelle (valeur ajoutée brute), mais repose sur un mécanisme budgétaire réversible, piloté chaque année en loi de finances. C’est d’ailleurs cette flexibilité budgétaire, plutôt qu’une supériorité économique, qui explique son succès politique [8] .
3.2 Pourquoi elle a dominé l’agenda (2006–2019)
Au milieu des années 2000, l’arbitrage politique se cristallise autour d’un objectif unique : baisser le coût du travail sans toucher au salaire net. En 2006, le rapport administratif conclut que, quelle que soit la modalité, l’effet macroéconomique resterait limité ; ce signal oriente les cabinets vers des instruments déjà maîtrisés (TVA, CSG, allègements), plutôt que vers une refonte d’assiette type CVA [13] .
En 2007, un rapport spécifique sur la TVA sociale est commandé : les simulations (DGTPE/MÉSANGE, COE–Rexecode, etc.) deviennent la référence technico-politique. Dès lors, le débat porte sur des taux et des montants, non sur l’assiette productive [14] [15] .
La séquence culmine début 2012 : le taux normal de TVA est relevé de 1,6 point pour financer environ 13 Md€ d’allègements, avant d’être abrogée par la nouvelle majorité [16] [17] [18] . Mais la logique demeure : à partir de 2013, le levier « coût du travail » est actionné via d’autres outils : création du CICE, puis transformation en 2019 en baisses pérennes de cotisations [19] [20] [21] .
Enfin, entre 2017 et 2019, Emmanuel Macron substitue 1,7 pt de CSG aux cotisations maladie et chômage côté salariés, et transforme le CICE côté employeurs. Là encore, on ajuste des instruments existants (CSG, cotisations, allègements), sans jamais interroger le choix de l’assiette [25] [26] [27] [28] .
En résumé : depuis 2006, la TVA sociale occupe l’espace politique parce qu’elle est « prête à l’emploi » dans la loi de finances. Cette logique institutionnelle explique pourquoi la TVA sociale ressurgit régulièrement dans le débat, sans jamais évoquer l’alternative CVA. De son côté, la CVA reste invisibilisée, alors que les rapports officiels ont établi sa faisabilité technique, sa compatibilité juridique européenne, et même un impact légèrement positif sur l’emploi (+28 000 postes selon les simulations de 2006). Contrairement à la TVA sociale, elle corrigerait en outre les iniquités sectorielles actuelles et stabiliserait l’assiette du financement social. C’est ce décalage entre potentiel documenté et invisibilité politique que les diagnostics récents vont mettre en évidence.
En 2012, Nicolas Sarkozy défend une TVA sociale (hausse du taux normal à 21,2 % contre baisse de cotisations famille), présentée comme un levier de compétitivité — sans référence à une cotisation assise sur la valeur ajoutée (CVA). En mai 2025, Emmanuel Macron remet sur la table l’idée de « taxer moins le travail et davantage la consommation », interprétée par la presse comme le retour de la TVA sociale — là encore, sans mention de la CVA [10] [11] .
Ce silence tient surtout à un effet d’agenda : depuis 2006, les documents publics de référence ont installé la TVA sociale comme option visible, tandis que la CVA a été relativisée. Les annonces et la couverture médiatique se sont donc focalisées sur des instruments « connus » (TVA, CSG, allègements), plutôt que d’ouvrir un chantier d’assiette (CVA) moins présent dans les notes de synthèse [12] .
4. 2009 – La démonstration par la CVAE
Ironie de l’histoire : trois ans après avoir écarté la CVA pour la Sécurité sociale, le législateur adopte en 2009 une réforme fiscale qui en reprend largement le principe. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), créée pour financer les collectivités locales dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle, est assise sur la valeur ajoutée brute. Autrement dit : la même assiette jugée fragile ou impraticable en 2006 devient soudainement opérable.
Mais la CVAE a rapidement montré ses limites. Bien qu’assise sur la valeur ajoutée, son taux effectif dépendait en réalité du chiffre d’affaires, via un barème dégressif. Deux entreprises créant la même richesse pouvaient ainsi être imposées de façon très différente, selon la taille de leur activité. Ce mécanisme a produit un effet régressif, faisant peser proportionnellement plus la charge sur les petites structures que sur les grandes, soit exactement l’inverse de ce qu’aurait permis une véritable CVA sociale. Cette distorsion explique en partie l’érosion continue du rendement de la CVAE : de plus de 16 Mds€ à son apogée, il est tombé à moins de 5 Mds€ en 2024 [22] , au moment même où Bercy réclamait 10 Mds€ d’économies supplémentaires [23] .
Notons au passage une confusion terminologique : malgré son nom de « cotisation », la CVAE était en réalité un impôt économique local, sans aucun lien avec la Sécurité sociale. Sa suppression engagée en 2023–2024 a définitivement rappelé qu’elle n’avait jamais été l’équivalent d’une CVA [24] .
Sur le plan technique, pourtant, la CVAE reposait sur un calcul simple : chaque entreprise déclare déjà sa valeur ajoutée dans ses comptes, puisque c’est un indicateur de base pour l’impôt sur les sociétés et la TVA. Le recouvrement a été assuré sans difficulté par la direction générale des finances publiques. Preuve que l’argument de la complexité ou de l’insécurité juridique n’était pas fondé : il s’agissait bien d’un choix politique d’affectation.
Les effets redistributifs de la réforme ont été documentés : dans le scénario discuté au Parlement en 2009, l’ industrie aurait bénéficié d’un allègement d’environ 7,5 Mds€, tandis que les banques, assurances et grandes surfaces auraient été davantage mises à contribution [9] .
Ce précédent reste crucial : si un prélèvement sur la valeur ajoutée a pu fonctionner pour les collectivités locales, rien n’empêche de l’appliquer à la Sécurité sociale. La seule différence réside dans l’affectation des recettes : collectivités territoriales dans le cas de la CVAE, caisses sociales dans le cas d’une CVA. Autrement dit : la question n’a jamais été technique, elle est institutionnelle et politique.
🔎 L’incidence réelle des cotisations patronales : ce que montrent les faits
Dès 1995, un rapport officiel au Premier ministre (Foucauld, Chadelat, Zaidman) constatait que l’augmentation des cotisations sociales employeurs « ne pèse en fait qu’à court terme sur les entreprises, puis se traduit par une hausse des prix et par une baisse équivalente du salaire réel brut de sorte que les ménages salariés sont in fine les véritables payeurs » [38] . Autrement dit, les cotisations patronales, présentées comme un coût pour l’entreprise, sont le plus souvent répercutées sur les salariés par le jeu des prix et la stagnation salariale.
Ce constat, posé dès le milieu des années 1990, est confirmé par Thomas Piketty dans Le Capital au XXIe siècle (2013). Il montre qu’après la mise en place des cotisations sociales à la Libération, la part des profits dans la valeur ajoutée n’a pas été durablement réduite. Dès les années 1960, le capital avait retrouvé son taux de profit historique : preuve que les cotisations patronales avaient été absorbées sans affecter durablement les revenus du capital [39] . La « charge patronale » s’est donc révélée, dans les faits, surtout une charge pour les salariés.
Ainsi, qu’on finance la Sécurité sociale par des cotisations sur les salaires, par une TVA sociale ou par la CSG, l’incidence économique retombe massivement sur les ménages. La différence avec une CVA est décisive : en intégrant les profits et dividendes dans l’assiette, elle réduit la possibilité de transférer l’effort contributif uniquement sur les salaires. La ressource reste de nature sociale (URSSAF) et non budgétaire (État), ce qui modifie en profondeur le rapport de force entre capital, travail et puissance publique.
Enfin, le choix de la valeur ajoutée brute (VAB) comme assiette renforce la robustesse du dispositif. Comme les amortissements y sont inclus, les multinationales (par ex. Amazon) ne peuvent pas effacer artificiellement leur valeur ajoutée en multipliant les filiales ou les redevances internes. La richesse produite sur le territoire reste visible et taxable, là où une valeur ajoutée nette offrirait davantage de marges d’optimisation.
5. Conclusion — Ce que change une CVA bien paramétrée
La CVA n’est pas un slogan : c’est une réforme d’assiette cohérente avec trois objectifs simples :
- Sécuriser une ressource sociale dynamique, moins sensible aux stratégies de contenu salarial et à l’externalisation.
- Équilibrer l’effort contributif entre secteurs à forte masse salariale et secteurs à forte intensité capitalistique (banques, plateformes, grande distribution, numérique).
- Rendre contributives les importations consommées en France (ajustement à l’entrée) et ne pas pénaliser l’export (exonération à la sortie), selon une logique déjà maîtrisée.
Principes de mise en œuvre :
- Assiette : valeur ajoutée telle que déclarée dans les liasses fiscales et comptes nationaux (base connue et auditée).
- Recouvrement : adossement aux canaux existants (DGFiP/URSSAF), avec un taux modeste mais appliqué à large base.
- Neutralité concurrentielle : exonération à l’export, contribution à l’import (principe d’ajustement déjà pratiqué).
- Gouvernance : affectation directe aux caisses sociales, comme ressource contributive et non fiscale.
Ces choix répondent directement aux constats des années 2010–2025 : après quinze ans de jeux de taux (CICE, allègements, CSG), il devient indispensable de revenir à la question de l’ assiette.
📚 À retenir :
Depuis près de 30 ans, la CVA est reconnue comme techniquement faisable et économiquement cohérente par tous les rapports officiels (Chadelat 1995, groupe interministériel 2006, compatibilité CJUE). Pourtant, elle reste invisible dans le débat public. Depuis 2006, l’option visible a été la TVA sociale, car elle est « prête à l’emploi » dans la loi de finances. Les diagnostics récents disent l’inverse : il faut des assiettes larges et stables. C’est exactement le terrain d’une CVA sérieuse — une réforme d’assiette qui fait contribuer les entreprises selon la richesse qu’elles créent vraiment, pas un énième réglage de taux qui laisse intactes les iniquités sectorielles actuelles.📌 Précisions utiles
Ce billet s’appuie sur un travail plus large développé dans mon mémoire complet. Pour situer le propos, voici quelques points de contexte :
- CVA modulée : L’analyse repose sur une hypothèse de CVA modulée selon le ratio masse salariale / valeur ajoutée, détaillée dans le mémoire. Ce paramétrage corrige les inégalités entre travail et capital.
- Neutralité : Les rapports officiels sont rigoureux mais reposent sur des choix méthodologiques orientés (scénarios, indicateurs). D’où l’importance de les lire avec esprit critique.
- CVAE ≠ CVA : La CVAE (2009) est un impôt local sur la valeur ajoutée brute. Elle montre que les freins techniques ou juridiques invoqués contre une CVA ne sont plus valables.
📊 Impact sur l’emploi : des estimations variables
Les différents rapports publics convergent : une CVA aurait un effet positif sur l’emploi. Mais les ordres de grandeur dépendent des hypothèses retenues :
- Rapport Chadelat (1997) : fourchette large selon les paramètres ( 40 000 à 400 000 emplois), avec la conclusion que l’effet serait « de toute façon positif ».
- Rapport du CPO (2006) : simulations macroéconomiques plus prudentes, limitées à une bascule partielle, estimant environ +28 000 emplois.
👉 La différence ne reflète pas une contradiction, mais le choix d’hypothèses : scénario exploratoire et ambitieux d’un côté, approche partielle et conservatrice de l’autre.
💡 En clair : ce texte s’appuie sur des faits établis, mais assume sa portée politique — contribuer au débat sur le financement de la protection sociale.
📌 À suivre…
FAQ
La CVA et la CVAE, est-ce la même chose ?
Non. La CVA serait une cotisation sociale employeurs affectée à la Sécurité sociale. La CVAE (2009) est un impôt économique local pour les collectivités : elle relève des finances publiques et n’est pas une cotisation sociale.
Qu’est-ce que la CVA ?
Une cotisation assise sur la valeur ajoutée brute (VAB) produite par l’entreprise, plutôt que sur la seule masse salariale, afin d’élargir et stabiliser l’assiette du financement social.
En quoi la CVA diffère-t-elle de la « TVA sociale » ?
La CVA change l’assiette du financement (cotisation affectée). La TVA sociale joue sur un taux de TVA (impôt) pour compenser des baisses de cotisations via la loi de finances.
Pourquoi la CVA a-t-elle été écartée en 2006 ?
Pour des raisons politiques et d’outillage existant (avis COE, synthèse CAS) alors même que sa faisabilité technique avait été étudiée par le groupe interministériel de mai 2006.
La CVAE de 2009 prouve-t-elle la faisabilité d’un prélèvement sur la VA ?
Oui : elle montre qu’une assiette “valeur ajoutée” est opérable. Mais c’est un impôt local, distinct d’une cotisation sociale nationale.
La CVA pénalise-t-elle l’investissement ?
Non. On ne taxe pas l’achat d’équipement : l’assiette VAB évite que les amortissements servent de « niche » et garantit la neutralité capital/travail.
Quid des exportations et des importations ?
La CVA se calcule sur la VA réalisée en France. Les questions d’ajustement aux frontières relèvent du cadre juridique (UE/OMC) et doivent être traitées par la loi.
Notes & références
- Paul Boccara, Une sécurité d’emploi et de formation, Paris, Le Temps des cerises, 1997. ↩️︎
- Commissariat général au Plan, Le financement de la protection sociale, rapport au Premier ministre, présidence Jean-Baptiste de Foucauld, rapporteurs Jean-François Chadelat et Catherine Zaidman, Paris, La Documentation française, 1995. (Collection des rapports officiels, B.30626, ISSN 0981-3764, ISBN 2-11-003409-02). ↩️︎
- Rapport interministériel sur le financement de la protection sociale, mai 2006. Résumé par Les Échos, « Réforme des cotisations patronales : le rapport qui fait hésiter le gouvernement », 31 mai 2006. URL : lesechos.fr. ↩️︎
- Conseil d’orientation pour l’emploi (COE), Avis sur les modalités de financement de la protection sociale, juillet 2006. ↩️︎
- CJUE, arrêt du 3 octobre 2006, affaire C-475/03 (Banca popolare di Cremona contre Agenzia Entrate Ufficio Cremona). Texte intégral disponible : eur-lex.europa.eu. ↩️︎
- « Financement de la protection sociale : qu’est-ce que la TVA sociale ? », Vie publique, 27 mai 2025. URL : vie-publique.fr. ↩️
- Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), Prélèvements obligatoires sur les ménages : progressivité & effets redistributifs, mai 2011 (rapport). PDF : ccomptes.fr. ↩️
- France Stratégie – Mission Bozio–Wasmer, Les politiques d’exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, 3 oct. 2024 (page de synthèse). URL : strategie-plan.gouv.fr. ↩️
- Claire Guélaud, « Les députés présentent leur scénario de réforme de la taxe professionnelle », Le Monde, 10 juin 2009 (proposition Balligand–Laffineur : création d’une cotisation sur la valeur ajoutée et chiffrage « industrie ≈ 7,5 Mds€ ; banques/assurances/GMS payent plus »). URL : lemonde.fr. — Pour le bilan consolidé de la réforme (allègement global 7,5–8,2 Mds€) : « Affiner (encore) la réforme de la taxe professionnelle », Le Monde, 27 juin 2012. URL : lemonde.fr. — Base légale de la CVAE : Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 (LF 2010), art. 2, Legifrance. ↩️︎
- Le Point, « TVA sociale : Sarkozy annonce une hausse à 21,2 % », 29 janv. 2012. URL : lepoint.fr. ↩️︎
- Public Sénat, « Emmanuel Macron relance le débat sur la TVA sociale », 14 mai 2025. URL : publicsenat.fr. ↩️︎
- COE, Avis sur les modalités de financement de la protection sociale, 20 juil. 2006 ; Centre d’analyse stratégique, La réforme du financement de la protection sociale – Avis de synthèse, sept. 2006. (Contexte : ces textes privilégient la hausse de TVA compensant une baisse de cotisations.) ↩️︎
- Les Échos, « Réforme des cotisations patronales : le rapport qui fait hésiter le gouvernement », 31 mai 2006. URL : lesechos.fr. ↩️︎
- Éric Besson, TVA sociale, sept. 2007 (rapport). URL : vie-publique.fr. ↩️︎
- Sénat, Rapport d’information n° 60 (2007–2008) – éléments de simulation issus du rapport Besson. URL : senat.fr. ↩️︎
- Le Point, op. cit. (annonce du 29 janv. 2012). ↩️︎
- Le Monde, « Les députés ont voté la suppression de la TVA sociale », 17 juil. 2012. URL : lemonde.fr. ↩️︎
- Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 — fin de la « TVA sociale » (analyse). URL : lexbase.fr. ↩️︎
- Ministère de l’Économie, « Le CICE, c’est quoi ? » (fiche officielle). URL : economie.gouv.fr. ↩️︎
- Conseil des ministres (24 sept. 2018) — PLF 2019 : bascule du CICE en allègements. URL : vie-publique.fr. ↩️︎
- France Stratégie, « CICE : a-t-il atteint ses objectifs ? » (synthèse, 30 sept. 2020). URL : vie-publique.fr. ↩️︎
- Rapports législatifs, « Projet de loi de finances pour 2024 : Relations avec les collectivités territoriales», 23 novembre 2023. URL : Sénat. ↩️︎
- banque des territoires, « Bercy demande 10 milliards d’économies supplémentaires » 11 juillet 2024. URL : Banque des territoires. ↩️︎
- Vie-publique, « Compensation de la disparition de la CVAE », 2023. URL : vie-publique.fr. ↩️︎
- Vie-publique, « Financement de la protection sociale : perspectives 2018 » (hausse de 1,7 pt de CSG et baisse des cotisations salariales). URL : vie-publique.fr. ↩️︎
- Legifrance, LFSS 2018 — suppression des cotisations salariales maladie et chômage, contre hausse de CSG. URL : legifrance.gouv.fr. ↩️︎
- INSEE, « Réformes des prélèvements 2018–2019 » (effets distributionnels). URL : insee.fr. ↩️︎
- Min. Fonction publique, « Indemnité compensatrice CSG » (décret 2017-1889). URL : fonction-publique.gouv.fr. ↩️︎
- France Stratégie, « Crédit d’impôt : le CICE a-t-il atteint ses objectifs ? », 30 septembre 2020 (synthèse : effet positif mais limité sur l’emploi, pas d’effet probant sur l’investissement). URL : vie-publique.fr. ↩️︎
- Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale (RALFSS) 2025 – Maîtriser la dynamique des allègements généraux, 26 mai 2025 (synthèse : de 20,9 Md€ à 77,3 Md€ entre 2014 et 2024). PDF : ccomptes.fr. ↩️︎
- Mission Bozio–Wasmer, page de présentation (octobre 2024) : objectifs, scénarios et cadrage méthodologique. URL : strategie.gouv.fr. ↩️︎
- Antoine Bozio & Étienne Wasmer, Les politiques d’exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, rapport final, octobre 2024 (PDF). URL : strategie.gouv.fr. ↩️︎
- INSEE, « En octobre 2018, les gains des réformes des prélèvements… », 12 mars 2019 (effets distributionnels de la bascule CSG ↔ cotisations). URL : insee.fr. ↩️︎
- Assemblée nationale, Rapport n°1148 présenté par Alfred Recours au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (Tome I : recettes et équilibre général), 1998. assemblee-nationale.fr. ↩️︎
- Henri Sterdyniak & Pierre Villa, « Réforme du financement de la protection sociale : quelles options ? », Revue de l’OFCE, n°66, janvier 1998, p. 155-184. sciences-po.fr. ↩️︎
- Sénat, Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 — Audition de Jean-François Chadelat (commission des affaires sociales), 13 octobre 1998. Témoignage sur les motifs, la faisabilité et les modalités d’une cotisation assise sur la valeur ajoutée. senat.fr. ↩️︎
- Jean-Paul Fitoussi, Henri Sterdyniak, Jacques Le Cacheux, « Pour une réforme du financement de la Sécurité sociale », Revue de l’OFCE, n°67, 1998, p. 179-183. URL : ofce.sciences-po.fr. ↩️︎
- Jean-Baptiste de Foucauld (prés.), Jean-François Chadelat et Catherine Zaidman (rapporteurs), Le financement de la protection sociale, Rapport au Premier ministre, Commissariat général au Plan, Paris, 1995, ISBN 2-11-003409-2. Citation p. 64 : « …l’augmentation des cotisations sociales employeurs ne pèse en fait qu’à court terme sur les entreprises, puis se traduit par une hausse des prix et par une baisse équivalente du salaire réel brut de sorte que les ménages salariés sont in fine les véritables payeurs ». ↩️
- Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013. L’auteur montre qu’après la mise en place des cotisations sociales dans les années 1945–50, la part des profits dans la valeur ajoutée n’a pas été durablement réduite ; dès les années 1960, le capital avait retrouvé son taux de profit historique. ↩️
- Les Échos, « Une solution préconisée en 1997 par le rapport Chadelat », 3 janvier 2006. URL : lesechos.fr. ↩️️